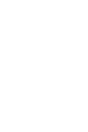L’édition numérique à l’ère du mobile : l’Afrique (1/3)
Dans cette nouvelle série d’articles, nous nous intéressons au paysage de l’édition numérique sur le continent africain. Pour les besoins de l’analyse, nous avons considéré, outre les publications électroniques développées par les maisons d’édition, les projets lancés par des organisations à but non lucratif et par le secteur public, dans un contexte caractérisé par de sérieuses difficultés d’infrastructure. Selon une tendance similaire à celle observée en Amérique latine, on remarque que seuls un petit nombre des acteurs locaux mentionnés dans le rapport de 2011 ont réussi à survivre jusqu’à aujourd’hui en Afrique. Dans la catégorie des sites de vente en ligne, par exemple, seul est resté sur pied le site sud-africain Exclus1ves. En revanche, parmi les tendances enregistrées il y a cinq ans, nombreuses sont celles qui se sont intensifiées de manière accélérée. Nous nous référons en particulier au boom de la téléphonie mobile comme plateforme privilégiée pour le commerce en ligne, l’interaction sociale et la lecture numérique, à l’influence des pépinières de start-ups sur la scène locale, et à l’impact grandissant des projets de coopération technologique portés, directement ou indirectement, par les géants globaux du Net. Tous ces facteurs s’avèrent décisifs pour comprendre dans sa spécificité la configuration de l’écosystème africain de l’édition numérique.
Dans cette première partie, nous analysons le rôle crucial joués par les téléphones portables dans le commerce électronique du continent, ainsi que l’avancée des grandes plateformes globales comme Facebook dans la vie numérique africaine.
Les téléphones portables sur le devant de la scène : leur impact sur le commerce électronique
Au cours de la dernière décennie, la téléphonie mobile a profondément transformé le paysage des communications en Afrique. Selon un rapport de la GSMA datant de juillet 2016, le continent héberge actuellement 565 millions d’utilisateurs de téléphones portables, dont plus de la moitié – 303 millions – disposent d’une connexion à Internet. Dans un contexte caractérisé par des limitations d’infrastructure de tout ordre, ces dispositifs relativement économiques et flexibles sont devenus une plateforme clé pour l’économie numérique. Si l’on considère le flux Internet qui circule via les téléphones portables, mesuré en pourcentage du flux total national, le Nigeria et l’Afrique du Sud sont en tête du classement mondial, avec respectivement 82 % et 75 %. Dans ces deux pays, l’accès à Internet s’effectue donc de façon prédominante à travers un téléphone mobile.
Dans le secteur du commerce électronique, les grands acteurs globaux n’ont pas encore réalisé d’irruption massive sur le continent. Une des explications possibles réside dans les problèmes d’infrastructure mentionnés précédemment : de fait, les obstacles que présente l’Afrique en matière de transport, de télécommunications, de bancarisation et d’alphabétisation ont retardé la mise en place du e-commerce sur le modèle américain ou européen. Ceci étant, la croissance économique accélérée de la région – que beaucoup comparent à l’avancée des pays asiatiques dans les années 60 – a favorisé l’émergence de nombreux acteurs locaux et, avec eux, la formation d’un écosystème particulier.
Fondé à Lagos en 2012 grâce à des fonds provenant de la pépinière allemande Rocket Internet, le portail Jumia s’est transformé en un véritable géant de l’Internet, présent dans plus de 10 pays d’Afrique. Il faut souligner que plus de 50% des utilisateurs de Jumia accèdent à la plateforme à partir de dispositifs mobiles. De l’avis de Tunde Kehinde – co-fondateur et directeur de la compagnie jusqu’en 2014, dans le secteur numérique, les contraintes du monde physique peuvent se transformer en avantages si l’on sait en tirer partie :
« Au Nigeria vivent 160 millions de personnes. Elles auront toujours besoin de s’acheter un T-shirt pour telle ou telle occasion, un téléphone pour joindre un ami, un livre… Mais il n’existe pas de marché organisé où trouver ce dont elles ont besoin, de manière simple et au prix qu’elles veulent. Alors nous nous sommes dit: “on ne va pas construire un centre commercial ; on va se lancer sur Internet” (…). Nous sommes en train de construire un Amazon dans un pays qui n’a pas connu de marché organisé en 50 ans d’indépendance. C’est une opportunité unique. »
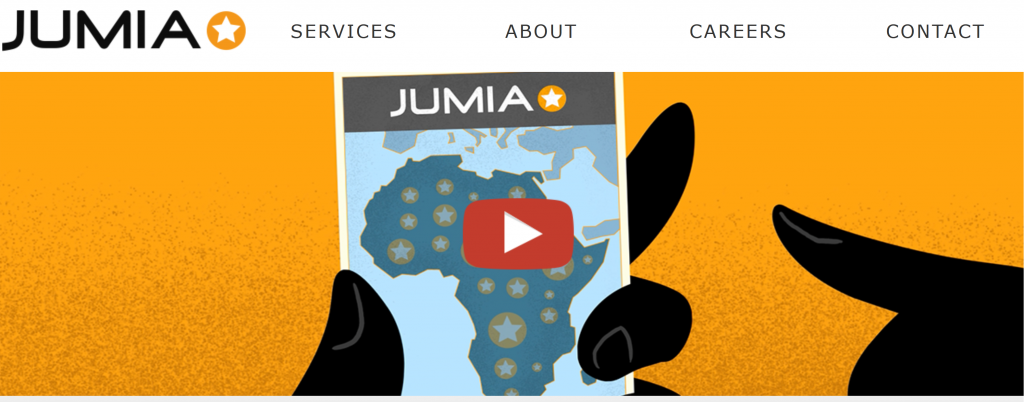
Site Web du groupe Jumia, leader panafricain du commerce électronique
Jumia constitue sans aucun doute un exemple emblématique, mais ce n’est pas un cas isolé : dans toute l’Afrique sont apparus d’innombrables portails qui parient sur le numérique pour dépasser les limitations propres au commerce physique. Parmi eux, on peut citer Konga, une plateforme elle aussi nigériane, les sud-africaines Bidorbuy et Takealot, ou la kenyane Rupu. Pour répondre aux défis logistiques, beaucoup de ces plateformes ont mis en place des systèmes de livraison par motocyclettes, allant parfois jusqu’à sous-traiter la logistique en faisant appel à des réseaux d’utilisateurs externes – il s’agit de crowd-shipping ou livraison collaborative.
La plupart du temps, le paiement s’effectue en liquide à la livraison, du fait du faible taux de pénétration des cartes de crédit et du manque de confiance dans les transactions en ligne. Le segment des paiements mobiles a malgré tout acquis un poids considérable au cours de ces dernières années. Outre M-Pesa, le service pionnier du transfert de fonds par SMS qu’utilisent au Kenya 7 adultes sur 10, les solutions comme Afrimarket, Paga, eTranzact ont proliféré dans la région, à l’instar d’autres solutions qui attirent des millions d’utilisateurs. Peu à peu, ces systèmes incorporent la possibilité de réaliser des paiements au niveau national, mais aussi international : c’est le cas d’Orange Money qui compte 19 millions d’abonnés et permet déjà les transferts d’argent entre différents pays d’Afrique ainsi qu’entre ces pays et la France.
Le commerce électronique africain, loin de suivre exactement le schéma en vigueur dans les pays développés, présente ainsi une configuration propre. Rania Belkahia – la directrice d’Afrimarket – s’en explique sans détours :
« Les modèles calqués sur la manière dont on procède dans d’autres parties du monde ne fonctionnent pas. [En Afrique], il faut parvenir à ce que l’offre s’adapte aux nécessités locales et puisse être livrée rapidement. »
Sacha Poignonnec, actuel directeur de Jumia, exprime un point de vue similaire :
« Aux États-Unis, le commerce électronique modifie lentement les vieilles habitudes d’achat. Ici, il crée ces habitudes. Les utilisateurs font des achats pour la première fois, et ils le font en ligne, via leur smartphone. »
Au bout du compte, malgré tous les défis préexistants – ou peut-être grâce à eux, le commerce électronique africain est parvenu à s’ouvrir un chemin de façon extrêmement dynamique. Selon des données de eMarketer datant de décembre 2015, les ventes en ligne ont connu en Afrique et au Moyen-Orient une hausse interannuelle supérieure à 28 %. En Amérique du Nord et en Europe occidentale, l’augmentation enregistrée sur la même période a été inférieure – autour de 14 %.
Les applications de messagerie mobiles
Le continent présente également une croissance manifeste dans le domaine des réseaux sociaux. Ainsi, selon les données de We Are Social, dans plusieurs pays d’Afrique, le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a augmenté plus vite en 2015 que le nombre total d’utilisateurs d’Internet. En Egypte, par exemple, le nombre d’internautes actifs sur les réseaux sociaux a fait un bond de 20 %. Sur la même période, le volume d’utilisateurs d’Internet a augmenté plus lentement, de 8 %.
Étant donné le contexte technologique particulier de l’Afrique, ce sont les applications de messagerie pour dispositifs mobiles qui présentent la plus forte activité. Dans le rapport de 2011, nous avions décrit le cas de Mxit, un projet sud-africain qui utilisait les téléphones portables les plus simples comme plateforme de fonctionnement et avait atteint une base de plusieurs millions d’utilisateurs. L’arrivée de smartphones vendus à des tarifs de plus en plus accessibles et l’irruption consécutive de Whatsapp dans la région a infligé un rude coup à Mxit, contraignant la société à mettre fin à ses activités commerciales en octobre 2015 en même temps qu’elle cédait sa technologie à Reach Trust – une organisation à but non lucratif. De fait, Whatsapp est actuellement l’application de messagerie numéro un au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud – où elle détient les plus forts indices d’utilisation du monde. Quoique moins répandue, l’application WeChat – du groupe chinois Tencent – commence elle aussi à trouver sa place.
Des projets de connectivité créés à l’instigation d’entreprises technologiques globales : le cas de Internet.org/FreeBasics (Facebook)
Contrairement à ce qui se passe en Asie ou en Amérique Latine, la pénétration de Facebook en Afrique reste limitée : à peine 8 % du trafic global enregistré par la plateforme provient de cette région, ce qui s’explique dans une grande mesure par le coût élevé des forfaits Internet. Dans ce contexte, Facebook a lancé en 2013 une initiative baptisée Internet.org dans le but de garantir la connectivité – un « droit de l’homme fondamental » selon Mark Zuckerberg – à des millions de personnes vivant dans des pays en développement. Grâce à une alliance avec différents opérateurs de téléphonie mobile, Facebook offre désormais un accès gratuit à son réseau social ainsi qu’à certains services fournis par des tiers, au travers de l’application FreeBasics, disponible dans 44 pays – dont la moitié sont situés en Afrique. Simultanément, l’entreprise a mis en œuvre divers programmes de connectivité à faible coût, comme le drone Aquila ou le système WiFi Express.
Vidéo publicitaire de FreeBasics (Facebook)
URL: https://www.youtube.com/watch?v=LIvYUft2wJM
Même s’il est clair que l’ensemble des pays en développement doivent faire face à d’énormes défis quant à l’infrastructure de connectivité, la solution proposée par Facebook pose plusieurs problèmes de fond. Il s’agit certes d’un projet qui facilite les possibilités de connexion, mais qui paraît imparfait sur d’autres plans, en particulier en ce qui concerne les contenus. En effet, Internet.org/FreeBasics ne fournit un accès qu’aux matériaux disponibles sur Facebook et aux applications qui ont accepté de faire partie du programme. Comme l’ont signalé de nombreuses organisations sociales, des schémas de ce type peuvent attenter à la neutralité du Web puisqu’ils assignent une priorité à un certain type de données et de contenus – ceux qui sont transmis par le réseau social californien et les services qui y sont associés. Cet argument a été décisif dans le processus qui a conduit à interdire FreeBasics en Inde. En Afrique, cependant, le projet a reçu un meilleur accueil, à tel point que dans certains pays les autorités de régulation dans le secteur des télécommunications ont admis que la mise en place de services permettant la transmission de données est aujourd’hui plus importante que la question de la neutralité du Web.
Au-delà des régulations adoptées par chaque État, il faut remarquer qu’au niveau global Internet.org/FreeBasics a suscité un vif débat. De nombreuses voix sont allées jusqu’à dénoncer une possible tentative de « colonialisme numérique » derrière les mesures philanthropiques du colosse technologique. C’est le cas par exemple de Deepika Bahri, professeur spécialisée dans les études postcoloniales à l’université d’Emory, qui énumère les similitudes entre le discours de Facebook et le modus operandi propre au colonialisme. Selon la chercheuse, dans les deux cas, la stratégie vise à :
- se présenter comme un sauveur ;
- répéter des mots comme « égalité », « démocratie », « droits fondamentaux » ;
- dissimuler ses motivations à long terme;
- justifier le fait que les bénéfices soient partiels sur le mode du « c’est mieux que rien » ;
- s’associer avec les élites locales et des groupes d’intérêts créés ;
- accuser les critiques d’ingratitude.
L’ingénieur et activiste indien Kiran Jonnalagadda établit quant à lui un parallèle entre l’extraction de ressources naturelles et la capture de données que mettent en œuvre, à échelle massive, des entreprises transnationales comme Facebook :
« D’un point de vue économique, le colonialisme consiste en l’extraction de matières premières à l’état brut et, simultanément, la vente aux consommateurs sans qu’il n’y ait création d’une classe capitaliste entre ces deux maillons. Ici, c’est la même chose : ils cherchent à obtenir les données brutes du consommateur et à vendre des services. Mais ils ne veulent pas d’intermédiaires. »
Enfin, Ethan Zuckerman – directeur du MIT Center for Civic Media – décrit crûment ce que peut être, au bout du compte, l’objectif de Facebook – une constatation qui, de fait, pourrait s’appliquer à bon nombre d’autres projets technologiques similaires :
« Le projet de Facebook me paraît colonialiste et mensonger. Il tente de résoudre un problème qu’il ne comprend pas ; il n’a d’ailleurs pas besoin de le comprendre, puisqu’il connaît déjà la solution. Cette solution contribue efficacement à conforter Facebook dans sa position de plateforme dominante du futur, à un moment où les marchés développés croissent moins rapidement. »
Dans la prochaine partie : les livres numériques à but non lucratif ; les publications éducatives distribuées par des agrégateurs et des start-ups locaux ; les agrégateurs généralistes et les sites de vente par abonnement.